Ma bibliothèque idéale
Cette bibliothèque idéale est pour le moins sélective ! Pour l'instant elle comprend dix ouvrages qui, parmi les centaines de livres que j'ai pu lire dans ma vie, ne sont rien de moins que de profonds coups de coeur, où j'ai vraiment senti qu' "il se passait quelque chose" à la lecture, quelque chose de foncièrement différent des autres livres, le plus souvent par le biais de l'écriture, sinon par celui de la narration, ou de l'atmosphère. Ordre non préférentiel.
Vos commentaires m'intéressent (mais la section prévue à cet effet n'existe pas encore, patience !), alors envoyez-moi un mél ou laissez un commentaire dans la dernière newsletter de la section Conseil Auteurs (que je ne peux que vous encourager à consulter si vous écrivez, en plus de lire... ;-))
A terme, ces pages seront ouvertes à vos suggestions de lecture ! 🙂
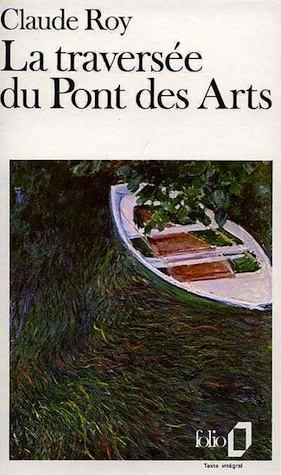 C'est un souvenir enchanteur et enchanté qui préside à mon choix de La Traversée du Pont des Arts, recommandé par une amie niçoise (Nathalie O) qui connaissait Claude Roy en personne pour avoir fait un mémoire de maîtrise/master sur lui.
C'est un souvenir enchanteur et enchanté qui préside à mon choix de La Traversée du Pont des Arts, recommandé par une amie niçoise (Nathalie O) qui connaissait Claude Roy en personne pour avoir fait un mémoire de maîtrise/master sur lui.
Je l'ai lu, curieusement, bien longtemps après avoir quitté Nice (allez savoir pourquoi), et outre le souvenir onirique et mystérieux tenace de cette histoire d'amour musicale et étrange, parente du réalisme magique, je garde surtout le souvenir de ma tristesse en fin de lecture : l'enchantement était terminé, le livre bouclé, j'en ai été triste quelques jours (et ce sentiment de lecture est bien rare !), comme quand on quitte un ami cher que l'on ne reverra pas avant longtemps. En clair je me suis sentie comme abandonnée ! Par ce petit bijou injustement méconnu.
Et le plus absurde de l'histoire est que je n'ai jamais relu ce livre depuis, à la fois par crainte d'être abandonnée une seconde fois, et par celle d'être déçue à la relecture, de ne pas retrouver la magie de la première lecture, de la même manière que l'on recommande de ne pas relire ces livres d'adolescence que sont Le Grand Meaulnes (Alain Fournier) et Le Pays où l'on n'arrive jamais
(André Dhôtel) que, à l'identique, je n'ai jamais relus.
Pour que le mystère reste entier et que je ne sois pas tentée de l'analyser, et alors de le détruire à jamais...
 La Tristesse des anges est une découverte récente entrevue rapidement à la fin de La Grande librairie, cette émission littéraire de Françoise Busnel sur France 5 que je ne saurais trop vous recommander, et que j'ai acheté pour deux raisons : l'enthousiasme de François Busnel lors de sa très brève présentation en fin d'émission, et le titre... C'est peu, mais suffisant, et je n'ai pas été déçue de ce choix pour le moins spontané puisque j'ai découvert là un des plus beaux livres qu'il m'ait été donné de lire !
La Tristesse des anges est une découverte récente entrevue rapidement à la fin de La Grande librairie, cette émission littéraire de Françoise Busnel sur France 5 que je ne saurais trop vous recommander, et que j'ai acheté pour deux raisons : l'enthousiasme de François Busnel lors de sa très brève présentation en fin d'émission, et le titre... C'est peu, mais suffisant, et je n'ai pas été déçue de ce choix pour le moins spontané puisque j'ai découvert là un des plus beaux livres qu'il m'ait été donné de lire !
Etrange, cette histoire l'est aussi, pour ce "roman de quête" islandais (je schématise) qui nous emmène d'étendue blanche en tempêtes, en bourrasques, en découvertes et en désespoirs. Ce qui est surtout soufflant dans ce texte c'est l'immense délicatesse de son auteur et l'extrême poésie de son style qui permettent d'espérer encore un peu en l'édition, et certains éditeurs courageux qui ne craignent pas de publier, ou de traduire, quelques trop rares fois, des livres aussi atypiques, et donc d'accès limité.
Saluons au passage la belle traduction, d'un traducteur dont le nom n'est pas indiqué sur Amazon...
Cette lecture fut un pur enchantement, que je ne craindrai pas de briser en la renouvelant par quelque longue soirée d'hiver bruxelloise. Parce qu'une fois lu, c'est un livre qui vous appelle, et vous appelle encore, à venir vous noyer dans des pages d'une pureté et d'une beauté difficiles à verbaliser. L'éditeur s'y est risqué, je lui laisse donc la parole...
Présentation de l'éditeur :
Lorsque Jens le Postier arrive au village, gelé, il est accueilli par Helga et le gamin qui le détachent de sa monture avec laquelle il ne forme plus qu un énorme glaçon. Sa prochaine tournée doit le mener vers les dangereux fjords du nord qu il ne pourra affronter sans l assistance d un habitué des sorties en mer. De son côté, le gamin poursuit sa découverte de la poésie et prend peu à peu conscience de son corps, des femmes, et de ses désirs. C est lui qu on envoie dans cet enfer blanc, « là où l Islande prend fin pour laisser place à l éternel hiver », y accompagner Jens dans son périple. Malgré leur différence d âge, leurs caractères opposés, ils n ont d autre choix que de s accrocher l un à l autre, s accrocher à leurs amours éloignées, pour ne pas céder à l impitoyable nature.
Avec une délicatesse poétique singulière, Jón Kalman Stefánsson nous plonge dans un nouveau parcours à travers les tempêtes islandaises. Au milieu de la neige et de la tentation de la mort, il parvient à faire naître une stupéfiante chaleur érotique, marie la douceur et l extrême pour nous projeter, désarmés et éblouis, dans cette intense lumière qui « nous nourrit autant qu elle nous torture ».
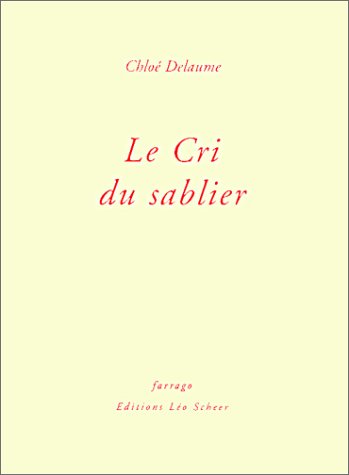 Une impression de lecture très différente pour Chloé Delaume, que je crois avoir découverte dans Le Matricule des anges (que j'ai lu fidèlement jusqu'à ce qu'ils fassent une remarque tellement ridicule sur l'une de mes traductions que je me suis désabonnée) il y a de cela quelques années.
Une impression de lecture très différente pour Chloé Delaume, que je crois avoir découverte dans Le Matricule des anges (que j'ai lu fidèlement jusqu'à ce qu'ils fassent une remarque tellement ridicule sur l'une de mes traductions que je me suis désabonnée) il y a de cela quelques années.
J'ai eu quatre chocs de lecture dans ma vie : L'Ecume des jours (Vian), à 17 ans, Le Château de Cène
(Bernard Noël), recensé ci-après à 30 et quelques années, Fleuve de cendres
(V. Bergen) découvert récemment et recensé ci-après également, et Le Cri du sablier.
C'est un roman, ou/et c'est un cri, on ne sait très bien comment le décrire ni où le classer et peu importe.
Oui c'est un cri, celui, autobiographique, d'une enfant dont le père a tué sa mère sous ses yeux et s'est suicidé ensuite, toujours sous les yeux de l'enfant... Faut-il le préciser, Chloé Delaume a tenté de se suicider treize fois déjà...
En attendant d'y parvenir vraiment, elle nous offre des livres pour l'essentiel magnifiques, violents, tonitruants, ciselants, comme son dernier, Une Femme avec personne dedans, que je vous recommande également.
Le Cri du sablier m'a, quant à lui, laissé le souvenir d'une véritable écriture, noire, violente et infiniment dérangeante, infiniment novatrice aussi.
Invitée à La Grande librairie, l'auteur y disait qu'il fallait bousculer le lecteur, lui donner des claques, voire le violenter.
Essai transformé, dirais-je.
Voilà un auteur, et un livre, que l'on ne sera pas prêt d'oublier, à condition d'avoir résisté, sans se noyer, à la traversée de ses mots !
Présentation de l'éditeur :
Le livre de Chloé Delaume est le récit d'une réminiscence. Il remonte le temps afin de faire voler en éclats un passé oppressant. Sa virulence a la puissance du cri. Véritable leitmotiv du roman, la métaphore du sablier se propage, se ramifie : elle dessine la figure centrale et traumatisante d'un père " sédimentaire " et d'une " enfant du limon ". Ni pathos ni complaisance. Mais la tentative, à l'âge adulte, de répondre au questionnement d'un enfant, tentative rendue possible par une certaine douceur de l'ironie. Tout passe par le prisme d'une langue singulière, débordante d'inventions. Le style est démesuré, tantôt lapidaire, tantôt abyssal. Les mots se bousculent, deviennent envahissants, jusqu'à donner une impression de fusion.
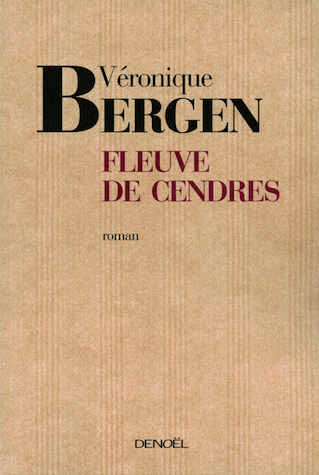 C'est par association d'idées, ou plutôt de sensations, que j'ai dû penser à ce livre immédiatement après Le Cri du sablier.
C'est par association d'idées, ou plutôt de sensations, que j'ai dû penser à ce livre immédiatement après Le Cri du sablier.
Là aussi, une grande grande découverte (redoublement intentionnel), celle d'un auteur atypique une fois de plus (Véronique Bergen est belge, et philosophe de formation) pour ce gros livre qui se dévore d'une traite pour peu que l'on aime la prose poétique (saluons Denoël en courageux éditeur) et que l'on ne craigne pas d'être dérangé (le lecteur perspicace aura remarqué mon goût très net pour ce genre de lecture...).
Rien ne me poussait vers ce Fleuve de cendres, dont l'auteur n'est pas très connu, c'est ma voisine, la charmante Maud Joiret, qui travaille pour l'association de promotion des auteurs belges (BELA) déjà évoquée sur ce site, qui me l'a prêté cet hiver 2012, me faisant également découvrir un recueil de poèmes (Glissements vers l'ouvert, chez Maelström) que j'ai acheté en dix exemplaires, pour offrir...
Mais revenons à Fleuve de cendres, qui pourrait se résumer à un cri aussi, mais qui est davantage un emportement, au sens aquatique du terme, celui d'un fleuve charriant le souvenir d'amours saphiques difficiles et allant se noyer sur les rives de la Shoah...
Rarement ai-je lu de lignes aussi violentes et poétiques sur cette triste thématique, dont Bergen sait parler avec une bouleversante acuité, plantant des fleurs de misère au sommet des barbelés...
A lire, absolument !
Présentation de l'éditeur :
Obsédée par les fêlures de son amante, une femme se perd dans de singulières joutes passionnelles sur fond d'océan... Comment endurer les cinglantes lignes de fuite de Chloé, amazone à la troublante armure ? Comment déchiffrer les langues intimes de son journal, vertigineuse tour de Babel intérieure dans laquelle cette dernière s'est enfermée à double tour ? Comment surtout découvrir le code secret à même de pénétrer les mystérieux écrits d'Ossip, son grand-oncle survivant des camps qui vient de se jeter dans la mer ? Au fil des jours se précise un tragique roman familial : la disparition des siens durant l'orgie de sang de la Seconde Guerre mondiale, l'interminable silence du dieu des Etoiles jaunes... D'une écriture visionnaire, Véronique Bergen conjugue les mille énigmes d'une passion à une hallucinatoire traversée des pulsions barbares du XXe siècle. Creusant les méandres d'un inépuisable panthéisme amoureux, elle nous happe dans la flamboyante folie de la guerre.
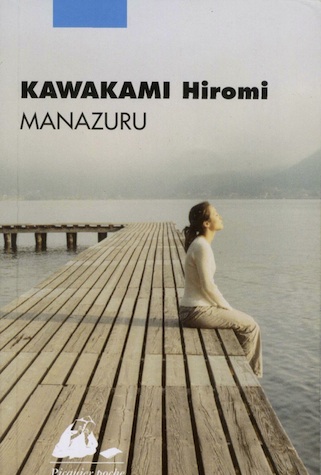 Avec Manazuru
Avec Manazuru (que j'ai prêté et offert deux fois en quelques mois) on est aux antipodes des lectures précédentes ! Point de noirceur, de tremblements ni de violence dans ce roman à la finesse rare.
Choisi "par hasard" ces derniers mois de 2012 sur une table consacrée au Japon (dont la littérature me fascine) dans la librairie Libris de la Toison d'or, Bruxelles (où d'ordinaire je vais très peu), ce livre a répondu à toutes mes attentes, et plus encore, concernant la littérature japonaise !
C'est un véritable petit bijou de délicatesse et de poésie ordinaire, pour un récit à la croisée de l'ici-bas et de l'au-delà, de l'onirisme et du réalisme, entrelaçant ces divers royaumes pour n'en tisser un seul, éclatant, émouvant autant que troublant, celui de Manazuru empli d'émotions et de sensations qui ne pourront que vous enchanter, je vous en fais la promesse !
Belle traduction d'Elizabeth Sutsuegu.
Je vous glisse ci-après la quatrième qui m'avait donné envie d'acheter ce livre, et qui est excellente !
Présentation de l'éditeur :
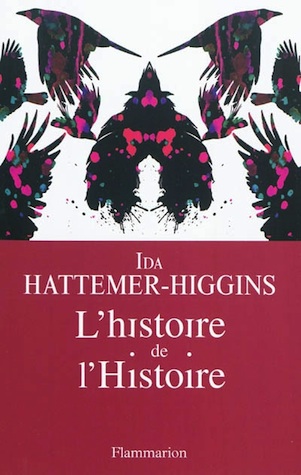 Lors de la rentrée littéraire 2011 j'ai été éblouie (le mot est juste) par ce premier roman qui, à l'instar d'autres premiers romans qui ne cessent de m'impressionner (je pense entre autre à Le Confident
Lors de la rentrée littéraire 2011 j'ai été éblouie (le mot est juste) par ce premier roman qui, à l'instar d'autres premiers romans qui ne cessent de m'impressionner (je pense entre autre à Le Confident, d'Hélène Gremillon, ou à Purge
), m'a laissé une impression durable, avec pour seul bémol la fin qui tombait un peu à plat, ai-je trouvé.
Mon choix s'est porté sur L'Histoire de l'Histoire à cause des excellentes recensions le concernant, mais aussi et surtout parce qu'il se passait dans le Berlin d'après guerre, ville qui m'intéresse au plus haut point (lire mes impressions à ce sujet), surtout au niveau historique. D'ailleurs, à mon sens, Berlin est l'autre héroïne du roman, au même titre que Margaret !
Et en cela ce livre ne m'a pas déçue, entremêlant judicieusement un Berlin réaliste avec un Berlin fantasmé pour le moins effrayant, fantasmagorique, symbolique et prégnant, un Berlin de chair et de sang, c'est le moins que l'on puisse dire ! Pour mieux comprendre cette allusion, je vous laisse avec la quatrième, non sans vous recommander chaleureusement ce premier roman étonnement puissant ! Traduit par Philippe Giraudon dont je n'ai rien à dire, ayant préféré lire le livre en anglais (je me méfie des traductions ! ;-))
Présentation de l'éditeur :
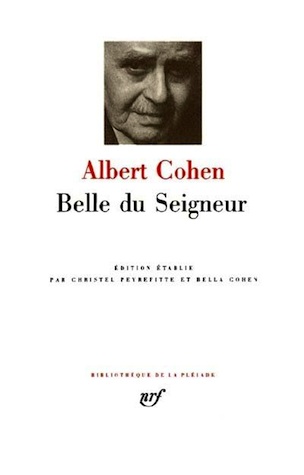 S'il y a bien un roman mythique (sur lequel les avis sont par ailleurs partagés), c'est celui-là !
S'il y a bien un roman mythique (sur lequel les avis sont par ailleurs partagés), c'est celui-là !
D'Albert Cohen, j'aurais aussi bien pu vous recommander Le Livre de ma mère ou Ô vous, frères humains
, aussi émouvants qu'impressionnants et dans une même veine lyrique, celle d'Albert Cohen.
Mais Belle du Seigneur est le premier ouvrage lu de lui, et c'est donc par son biais que j'ai découvert pour la première fois l'écriture unique d'Albert Cohen.
Première recommandation, faite par celui qui me l'a prêté à Nice (merci, Claude Chastagner !) et elle est primordiale : ne pas se laisser désarçonner par ledit style et ledit lyrisme, opulent autant que foisonnant, qui peut être très difficile à appréhender lors d'une première découverte (c'est pourquoi je vous recommande chaudement de commencer par du plus petit Cohen, voir supra, histoire de vous acclimater...). Il convient donc de s'accrocher pendant les... 100 premières pages, après quoi, en vérité je vous le dis, vous serez récompensés, voire peut-être même éblouis !
Seconde recommandation, la mienne : n'abordez pas ce livre comme étant le plus beau roman d'amour du siècle, une éloge de la passion, que nenni, c'est même tout le contraire, à mes yeux en tout cas. Belle du Seigneur est, je persiste et je signe, le roman le plus cruellement réaliste jamais écrit sur les ravages de la passion, et la relation délétère qu'inévitablement elle entraîne ! Vous voilà prévenu(e) !
Voici que qu'en dit Gérard Meudal :
"Du joli, la passion dite amour. Si pas de jalousie, ennui. Si jalousie, enfer bestial. Elle une esclave et lui une brute. Ignobles romanciers, bande de menteurs qui embellissaient la passion, en donnant l'envie aux idiotes et aux idiots." Albert Cohen n'embellit pas la passion mais l'analyse avec une lucidité sans pareille. Des amours entre Ariane et Solal dans la Genève du début du siècle, il n'élude aucun aspect, ni la marche triomphale de la passion, ni les affres de la jalousie, ni la brutalité d'une relation plutôt sadique mais son roman demeure une des histoires d'amour mythiques de la littérature. Brossant au passage un tableau féroce du milieu des fonctionnaires internationaux où il a lui-même fait toute sa carrière, mêlant un foisonnement de récits secondaires à l'intrigue principale et passant avec une maîtrise consommée du lyrisme le plus échevelé au constat le plus froid, Albert Cohen donne avec Belle du Seigneur non seulement son oeuvre maîtresse mais un des plus beaux romans du XXe siècle."
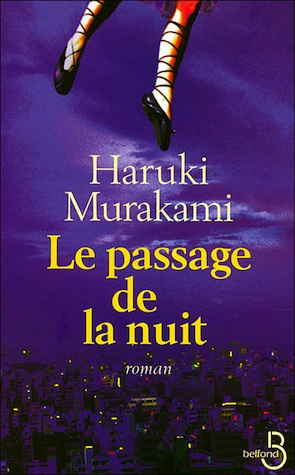 Et l'on arrive au fameux Murakami (Haruki, pas l'autre), dont je ne parlerai certainement pas du non moins fameux 1Q84
Et l'on arrive au fameux Murakami (Haruki, pas l'autre), dont je ne parlerai certainement pas du non moins fameux 1Q84 à la réputation à mon sens plus qu'usurpée tellement ce livre m'a déçue (attention, il se lit bien, il y a du suspense, mais l'histoire d'amour est mièvre, la fin décevante, et 3 volumes pour ça, noooon !).
Et dire que je l'avais acheté en anglais pour pouvoir le dévorer le plus vite possible... !
J'aurais pu mettre ici La Fin des temps, mon premier Murakami, qui m'avait enchantée et signe le début d'autant de belles découvertes. Ou, La Course au mouton sauvage
, Kafka sur le rivage
ou encore Chroniques de l'oiseau à ressort
, tous sublimes.
Histoire d'amorcer la découverte, j'aurais pu vous parler de Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, ou encore d'Après le tremblement de terre
, qui constituent d'excellentes approches (plus succintes aussi) de Murakami, et que j'offre régulièrement autour de moi.
Mais j'ai décidé de parler d'un de ses livres nettement moins connus, Le Passage de la nuit, qui m'a enchantée à plus d'un égard, comme beaucoup de livres de Murakami.
L'on y retrouve en vrac son habituelle poésie, son sens pour le moins aigu du décalage, son entrelacs de rêve et de réalité, ses touches fantastiques, et surtout, surtout, ce qui moi m'a enchantée, c'est ce double portait : celui d'une ville (Tokyo), et celui de cette ville la nuit, une atmosphère que j'ai toujours prisée dans quelque ville que ce soit (voir mes villes préférées si d'autres portraits de ville sont susceptibles de vous intéreser) et qui m'a tout bonnement enchantée dans ce Murakami injustement méconnu et d'une cuvée très spéciale !
Traduction de Théodore et Hélène Morita.
Présentation de l'éditeur :
Pour une nuit, Haruki Murakami nous entraîne dans un Tokyo sombre, onirique, hypnotique. Un éblouissant roman d'atmosphère à la poésie singulière, aux frontières de la réalité et du fantasme, où chaque détail, rétrospectivement, fait sens.
Dans un bar, Mari est plongée dans un livre. Elle boit du thé, fume cigarette sur cigarette. Un musicien surgit, qui la reconnaît. Au même moment, dans une chambre, Eri, la soeur de Mari, dort à poings fermés. Elle ne sait pas que quelqu'un l'observe. Autour des deux soeurs vont défiler des personnages insolites : une prostituée blessée, une gérante d'hôtel vengeresse, un informaticien désabusé, une femme de chambre en fuite. Des événements bizarres vont survenir : une télévision qui se met brusquement en marche, un miroir qui garde les reflets. À Tokyo, le temps d'une nuit, va se nouer un drame étrange…
 Que voilà ici une grande grande découverte (redoublement intentionnel ici aussi) que je dois à Nadine Monfils (auteur de polars déjantés - voir ma newsletter à ce sujet -après moult nouvelles fantastiques ou érotiques), à l'époque où elle m'enseignait (ainsi qu'à d'autres) l'art de la nouvelle, et qui avait eu la grande bonté de trouver que mon écriture ressemblait à celle de Bernard Noël, dont j'ignorais tout à l'époque...
Que voilà ici une grande grande découverte (redoublement intentionnel ici aussi) que je dois à Nadine Monfils (auteur de polars déjantés - voir ma newsletter à ce sujet -après moult nouvelles fantastiques ou érotiques), à l'époque où elle m'enseignait (ainsi qu'à d'autres) l'art de la nouvelle, et qui avait eu la grande bonté de trouver que mon écriture ressemblait à celle de Bernard Noël, dont j'ignorais tout à l'époque...
Coup de poing et révélation que ce Le Château de Cène et son écriture superbement poétique, étonnante, neuve, déchirante, noire et violente !
Ma dernière (et première) lecture érotique remontait à Bataille (Mme Edwarda), en terminale, mais je dois dire que l'on est ici cent coudées au-dessus, vraiment ! Pourquoi ? Parce qu'ici l'on est porté(e) en plus par la beauté, inouie, de la poésie de Bernard Noël, que beaucoup connaissent d'ailleurs uniquement comme poète (Son Journal du regard est à lire absolument aussi !), alors qu'il est bien plus que cela !
Pléthore d'adjectifs ne lui rendra aucun hommage à la hauteur de son immense talent.
Le mieux est encore d'oser plonger, et de se délecter de la noyade !
Présentation de l'éditeur :
Être inacceptable... Il ne s'agissait pas de faire scandale ni violence, mais de céder à l'emportement d'une révolte qui, en soulevant l'imagination, combattait la censure intérieure et la réserve timide. L'écriture fut en tout cas un moment de jubilation et de liberté intenses, car être inacceptable conduit simplement à ne pas accepter les oppressions de l'ordre moral et de sa propre soumission. Ce livre, poursuivi pour outrage aux moeurs, est-il devenu inoffensif ? Ou bien la censure s'est-elle faite plus subtile en privant de sens - donc de plaisir - aussi bien les excès imaginaires que les valeurs raisonnables ?
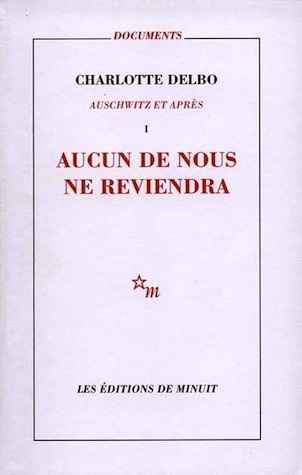 Encore un bel ouvrage, très bel ouvrage que ce Aucun de nous ne reviendra
Encore un bel ouvrage, très bel ouvrage que ce Aucun de nous ne reviendra, injustement méconnu (sur un sujet qui l'est tristement moins), mais il ne sera pas dit que ma bibliothèque idéale ne servira pas à rendre hommage à ceux passés injustement inaperçus !
Tout le monde (ou presque) a lu (ou cite) Primo Lévi, Si c'est un homme, tout le monde (ou presque) a lu L'Espèce humaine
de Robert Antelme (ex mari de Duras), qui certes sont très bien, mais peu de gens ont lu Hetty Hillesum, Une vie bouleversée
, à lire absolument, et peu de gens aussi connaissent ou citent Charlotte Delbo dans sa terrible trilogie parue chez Minuit : Auschwitz et après (Aucun de nous ne reviendra
, Une connaissance inutile
, Mesure de nos jours
).
Je l'ai découverte sur scène à Bruxelles à l'époque où je travaillais sur un autre "portait Shoah" que celui du moment (voir ici), et n'avais eu de cesse de me procurer ces livres immédiatement.
Pour la première fois dans ma lecture de livres sur la Shoah (à part Fleuve de cendres de V. Bergen recensé plus haut mais qui n'est pas le récit d'une rescapée) je découvrais enfin un rescapé qui en parlait de manière littéraire, voire par moments poétique. Et ça change tout ! Non que les récits de Primo Levi ou Robert Antelme ne soient pas poignants, ils le sont, infiniment, mais Charlotte Delbo atteint, dans cette trilogie, un degré de vérité et un déploiement de l'insoutenable que seule la poésie pouvait rendre.
Car les mots sont bien impuissants à parler de cette horreur-là - j'en sais quelque chose, moi qui me bats depuis des mois avec la terrible destinée de Julius Wolff, matricule 902 du convoi 51 pour Majdanek - et c'est là que les mots littéraires, les mots poétiques, parviennent à aider à toucher un peu plus du doigt ce que cela a dû être. Un peu, très peu sûrement par rapport à l'immonde réalité, mais un peu plus tout de même, de cela je suis persuadée pour avoir beaucoup lu sur le sujet.
Plus intéressant encore est son troisième opus, La Mémoire et les jours, qui a l'infini mérite de parler d'une période de la déportation dont on parle peu, et qui a pourtant son importance : le retour ! Et la douloureuse réinsertion dans le quotidien, au milieu de tous ceux qui ne veulent pas entendre, ni comprendre.
S'il n'y avait que trois livres à lire sur la Shoah, à mes yeux ce seraient ceux-là, sachant par ailleurs que la plupart des autres récits sont des récits d'hommes.
Mon grand regret est d'avoir découvert ces livres après le décès de Charlotte Delbo, et de ne pas avoir pu lui dire à quel point ils m'avaient bouleversée.